Bibliographie
Section issue du cours ” Préparation au mémoire ” de Nicolas Vannson , PhD
Cette page est consacrée à réalisation de ta bibliographie, étape indispensable à la réalisation de ton mémoire.
La bibliographie n’est pas seulement un agencement de sources à la fin d’un document, c’est avant tout le début de ton mémoire où tu vas regarder ce qui a déjà été réalisé.
Ci-dessous, tu auras des astuces pour faire une bonne recherche bibliographique et aussi des astuces pour bien citer tes sources.
Si besoin, contacte nous !
Bonne biblio et bon mémoire !
Comment faire une bonne bibliographie ?
En guise d’introduction
La recherche bibliographique ou tout simplement « bibliographie » est la première étape essentielle dans la réalisation d’un travail de fin d’études (ou mémoire). C’est pourquoi il ne faut pas la négliger.
Mais que veut dire “bibliographie” ?
La bibliographie est une liste de sources (articles scientifiques, magazines, interviews, etc) qu’il faut collecter, lire, agencer afin d’avoir une idée plus précise d’une question que nous nous posons. Au quotidien, chaque personne intéressée par un sujet va se renseigner, creuser une thématique afin de gagner en expertise. Elle fait donc une recherche bibliographique sans le savoir. Pour un étudiant finissant, la bibliographie répond à une question majeure : « Est-ce que mon sujet a déjà été fait ?». Mes étudiants me l’ont souvent posée.
Seule une recherche méticuleuse pourra y répondre. Souvent des étudiants en lisant les travaux déjà réalisés ou bien des articles scientifiques de bonnes factures se rendent également compte que leur question initiale est bien trop vague ou qu’ils doivent encore l’affiner. Dans certains cas, le sujet a déjà été traité. Mieux, il est juste devant eux prêt à faire !
L’objectif de cet article consiste à expliquer la démarche bibliographique de manière simple et pratique.
Nous allons donc expliquer comment réaliser une bonne démarche bibliographie à travers deux petits exemples d’utilisation et de maniement des outils bibliographiques choisis : Google Scholar (pour faire sa recherche) et Zotero (pour la gestion). Il y a , bien sûr d’autres outils. Une section sera également consacrée à nos amis fan de Latex.
Bonne lecture et bon mémoire !
I – Le niveau de preuve : outil de confiance d’une source
Comment commencer sa démarche bibliographique ?
Faisons simple !
Quel crédit donner à une source ? Un peu ou beaucoup de confiance ? Dans tous les cas, il faudra absolument « croiser ses sources », c’est-à-dire vérifier la véracité des faits en observant si plusieurs auteurs ou sources ont rapporté le même fait/ la même expérience !
En France, d’après Haute Autorité de Santé (H.A.S) [1], il existe 4 niveaux de preuves et 3 grades ou niveau de confiance (Table 1). Par ailleurs, chaque pays possède son propre modèle de santé ainsi que sa propre gradation ou niveau de preuve [1]. Pour un mémoire à Cahors, les grades H.A.S seront à privilégier.
| Grade | Type d'étude | Importance |
|---|---|---|
| A | Niveau 1 Méta-analyse Essai contrôlé randomisé de forte puissance statistique | Preuve scientifique établie |
| B | Niveau 2 Essai comparatif randomisé de faible puissance Étude comparative non randomisée bien menée Études de cohorte | Présomption de preuve |
| C | Niveau 3 Cas témoins Niveau 4 Étude comparative comportant des biais importants Étude rétrospective Séries de cas Étude épidémiologique descriptive (transversale, longitudinale) | Faible niveau de preuve scientifique |
Table 1. Grades (ou niveaux de confiance) définis par la H.A.S.
Le niveau de preuve (ou confiance) d’une source ?
Le niveau de preuve le plus élevé est “1” (grade A) et est considéré comme le plus fiable. Il comprend les méta-analyses et les études randomisées. Une méta-analyse consiste à appliquer une méthode scientifique à une revue de la littérature. Les deux points sont à distinguer d’un point de vue méthodologique puisque la revue (ou review en anglais) regroupe tout simplement les études d’un sujet alors que la méta-analyse applique un filtre en sus, défini à l’avance par les chercheurs afin de répondre à une problématique précise. Il y a souvent un graphique type associé à la méta-analyse : le forest plot.
Un essai (ou étude) contrôlé randomisé est un type étude dans lequel les sujets malades sont répartis en deux groupes de façon aléatoire. Par exemple, pour tester l’effet d’un traitement sur le cancer, 20 malades atteints du même type de cancer sont divisés en un groupe contrôle (qui ne recevra pas le traitement mais un placebo) et un groupe sujet qui recevra le traitement. En médecine notamment, ce type d’étude est considéré comme le GOLD STANDARD. Pour affiner votre recherche sur les essais randomisés, vous pouvez consulter la page Wikipédia dédiée.
Point important, dans ce tableau se trouve la notion de puissance statistique. Cette notion est importante car elle définit le niveau de confiance statistique par rapport au nombre de sujets inclut dans une étude afin de limiter l’erreur de type 2 (ou risque bêta), c’est-à-dire d’affirmer que l’étude ne trouve pas effet significatif alors qu’il existe. Généralement, une forte puissance statistique est de 0.8 soit 80%. Vous pouvez trouvez un très bel exemple du calcul de la puissance statistique sur le site biostatgv ainsi que plein d’autres infos sur les stats.
Le niveau 2 ou grade B inclut les études de cohorte et les études non randomisées. Une étude non-randomisée signifie que les sujets ont été groupés de manière volontaire par le testeur dans le groupe contrôle ou patients. Cela peut introduire un biais important de sélection des patients. Une étude de cohorte est souvent comparée à un groupe sain, par exemple un groupe de patients presbyacousiques comparés à des jeunes normo-entendants.
Le grade C est le niveau de preuve scientifique le plus faible. La rigueur de lecture et d’utilisation de ces sources est de mise. C’est important afin d’éviter de fausser votre questionnement. Le niveau 3 comprend le cas témoin. Souvent une maladie observée chez un patient comme l’exemple d’une femme de 24 ans vivant sans cervelet ! Enfin, une étude descriptive d’une population qui ne fait que rapporter “un fait” sans avoir à le comparer. Par exemple, demander à tous les diplômés leur secteur d’activité et leur niveau de salaire à l’embauche.
Vous trouverez beaucoup de détails concernant le type d’étude dans la section matériels et méthodes des articles.
II – Google Scholar : outil dédié à la recherche bibliographique
Par où commencer sa recherche bibliographique ?
Faisons simple ! Par Google Scholar !
Bien qu’il existe plusieurs autres sources, Google Scholar est un outil très pratique ! Une fois bien maîtrisé, la recherche bibliographique devient presque un jeu d’enfant. Ce chapitre est un petit tutoriel sur la façon de bien utiliser Google Scholar dans la recherche de différentes sources bibliographiques. Une fois identifiée, une source bibliographique devra être sauvegarder et agencer pour être citer lors de la rédaction. Il existe également une multitude d’outils pour agencer sa bibliographie. On peut citer,par exemple, le très bon Zotero (pour plus d’informations, tu peux consulter, la rubrique liens web utiles de la section outils de MEMAU).
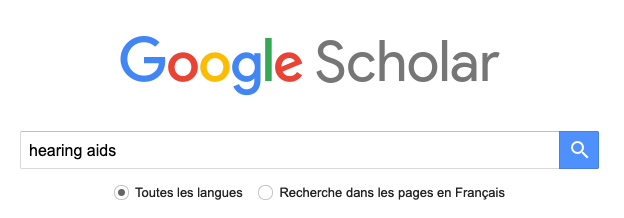
Figure 1 – Exemple de recherche sur Google Scholar.
Pour commencer, voici l’image (Figure 1) de la barre de recherche de Google Scholar (somme toute classique). Pour le tuto, j’ai tapé le mot « hearing aids » ou aide auditive. La majorité des recherches se font en anglais mais elles peuvent se faire aussi en français. Néanmoins, le nombre de sources disponibles sera malheureusement plus faible.

Figure 2 – Résultat de la recherche sur Google Scholar sans filtre.
Sur la page des résultats (Figure 2), il y a schématiquement 3 colonnes :
— La colonne de gauche pour affiner la sélection
— La colonne centrale avec les articles répertoriés
— La colonne de droite avec un potentiel lien vers l’article en pdf. Potentiel signifie que l’article n’est pas toujours disponible gratuitement et il faudra trouver un autre moyen pour l’obtenir.
Au jour de la rédaction de cet article (octobre 2024), le résultat de la recherche (Figure 2) indique 2 150 000 références possibles pour le mot “hearing aids”. Dans le coin en haut à gauche, il y a les dates. Ici aucun filtre n’a été appliqué. Cela explique donc le grand nombre de sources disponibles. Mais intéressons-nous aux sources disponibles depuis l’année 2024 uniquement. Il suffit pour cela de cliquer sur « Depuis 2024» (Figure 3).

Figure 3 – Résultat de la recherche sur Google Scholar en ayant sélectionné la date 2024.
La recherche avec le filtre “Depuis 2024” (Figure 3) nous donne maintenant que 15 500 sources disponibles. Nous commençons à restreindre notre problématique en cherchant des informations récentes sur les appareils auditifs. Je peux également ajouter un mot-clef, par exemple “children”, à “hearing aids” dans la barre de recherche de google Scholar en tapant : children + hearing + aids. De cette façon, la recherche se focalisera sur tous les articles qui ne traitent QUE de l’appareillage auditif pédiatrique.

Figure 4 – Bibliothèque sur Google Scholar.
Gérer l’export de ses recherches
Maintenant voici une astuce pour conserver toutes ses recherche et faire le tri par la suite. En haut à droite de la Figure 4 se trouve l’onglet : “Ma bibliothèque”. Cet onglet te permet de sauvegarder toutes tes sélections. Pour cela il suffit de cliquer sur la petite étoile “Enregistrer” en-dessous de la source. Par exemple le premier article en haut de la liste : « Future of hearing aids … » va se trouver dans ma bibliothèque Scholar (Figure 5) et ensuite il faudra cliquer sur ” Ma bibliothèque” pour avoir toute la sélection d’article.

Figure 5 – Liste de références dans “Ma bibliothèque”.
Pour l’exportation vers Zotero, il faut choisir le format “EndNote” et en Latex le format “Bibtex” (Figure 6). Le fichier exploitable par Zotero apparaîtra dans votre dossier téléchargement sous le nom« citations.enw ». Il faudra ensuite l’importer dans Zotero.

Figure 6 – Exportation de toutes les références de “Ma bibliothèque”.
III – Zotero : outil dédié à l’agencement de sa bibliographie
Une fois le travail de bibliographie effectué sur Google Scholar ou sur un autre site, il faut maintenant regrouper ses sources afin de savoir lesquels utiliser pour rédiger son mémoire correctement. Pour cela, nous allons utiliser Zotero (Figure 7) qui est un logiciel sous licence GNU. Tu trouveras également des d’explications sur Zotero.org.

Figure 7 – Logiciel Zotero.
La page d’accueil de Zotero se compose de 3 blocs. Celui de gauche vous permet de créer des “bibliothèques” ou des dossiers personnalisables en fonction de tes thématiques. Le bloc central te permets d’afficher toutes les sources contenues dans ton dossier. Par exemple (Figure 7), le bloc central affiche toutes les sources bibliographiques contenues dans le dossier “CAMILLE”. Le bloc de droite te permets d’éditer votre source (en cliquant dessus) si celle-ci est incomplète ou mal indiquée.
Comment importer une source dans Zotero ?
Il existe plusieurs façons d’importer une source :
La plus simple consiste à importer le D.O.I (Digital Object Identifier) d’un article dans l’onglet juste à droite du + en vert (Figure 8). Par exemple, DOI : 10.1007/s10162-021-00799-y (Article : Hearing Impariment and Cognition in an Aging World ; Powel et al.,2021 ;JARO).

Figure 8 – Import d’une référence bibliographique sous Zotero via le D.O.I.
La deuxième consiste à importer soit un article seul, soit un un ensemble de référence comme “citations.enw” généré par Google Scholar (voir chapitre : Google Scholar). Pour cela, il faut aller dans l’onglet FICHIER de Zotero,puis IMPORTER, puis sélectionner UN FICHIER et puis valider. Vous aurez alors un nouveau dossier avec toutes vos références bibliographiques. Enfin la dernière, consiste à l’ajouter manuellement en créant l’intégralité de la référence en cliquant sur le bouton + vert (Figure 9). Il y a un large choix de types de document à ajouter.

Figure 9 – Import manuel d’une référence bibliographique sous Zotero.

Figure 10 – Connector.
Une petite astuce bien pratique !
Voici une petite astuce pour te faciliter la recherche bibliographique. Vraiment ! Cette astuce permet de faire des recherches sur Google Scholar et de les ajouter directement dans la bibliographie Zotero sans devoir les exporter de Scholar puis de les importer dans Zotero. C’est pas génial ça ! C’est le Zotero connector for firefox (Figure 10). Ce connecteur existe aussi pour d’autres navigateurs.
Alors comment fonctionne ce “connector” ? Après avoir installé ce petit module sous Firefox, tu obtiendras un dossier en haut à droite de ton écran dans les onglets “modules supplémentaires installés” de Firefox. Une fois ta recherche précisée, tu pourras, AU CHOIX, cliquer sur l’étoile pour faire une sauvegarde dans ta bibliothèque Scholar, télécharger l’article individuellement, ou bien ajouter le ou les article(s) à ton dossier dans Zotero (Figure 11). Pour cette dernière option, en cliquant sur le petit dossier en haut à droit de ton écran, une fenêtre (Figure 11) s’ouvrira au centre de la page avec tous les articles de la page, il te suffira de cocher celui (ou ceux) qui t’ intéresse(nt) et de cliquer sur « Ok ». Zotero les enregistrera ensuite dans le dossier préalablement choisi.
Pour utiliser Zotero avec scholar, il faudra au préalable avoir installé Zotero, l’avoir ouvert et choisi un dossier pour que scholar puisse communiquer avec Zotero.

Figure 11 – Exemple d’utilisation du connector de Zotero.

Figure 12 – Exemple d’utilisation de Zotero avec Word.
Comment utiliser Zotero avec Word ?
Une fois Zotero installer sous Word (l’installation est assez simple et varie en fonction de la version de Word), un onglet “Zotero” apparaîtra dans le ruban de Word. Il suffira alors de cliquer dessus et d’ouvrir Zotero en parallèle afin de pouvoir citer une référence bibliographie dans le texte. A l’endroit voulu dans le texte, il suffira de cliquer, en haut à gauche sur “add citation” (ajouter une citation), une barre rouge apparaîtra et il suffira de taper les premières lettres de la références (comme dans l’exemple de la Figure 12). Une fois la citation placée dans le texte, la bibliographie, en fin de document, se mettra à jour automatiquement.
Pour finir, voici un exemple de bibliographie réalisée sous Zotero (Figure 13). A toi de jouer maintenant!

Figure 13 – Exemple d’une bibliographie finalisée sous Word à l’aide de Zotero.
IV – La bibliographie avec Latex
Pour nos amis fan de Latex, que faut-il faire pour agencer sa bibliographie ? C’est bien simple.
Pour commencer, dans le document maître de Latex (“main.tex”), il faudra ajouter ces deux lignes de codes (à la fin avant “\end(document)”) et choisir le type de bibliographie ainsi que le nom du fichier bibliographique en “.bib” qui contiendra toutes les sources bibliographiques du document.
\bibliographystyle{plain}
\bibliography{mon_fichier.bib}
Le format APA sous Latex est le type “ACM” sous Latex.
Depuis Google Scholar, il suffira soit d’aller dans “Ma bibliothèque” et d’exporter au format Bibtex (Figure 14), l’ensemble des sources référencées, soit de cliquer sur “citer” (symbole des apostrophes) puis de sélectionner Bibtex (Figure 15).

Figure 14 – Exemple d’exportation au format Bibtex pour Latex.

Figure 15 – 2e exemple d’exportation au format Bibtex pour Latex.
Voici un exemple de citation qu’il suffira de copier/coller dans le fichier bibliographique .bib. Tu pourras éditer ce fichier ainsi que chaque source sans problème.
@article{tasnim2024review,
title={A review of machine learning approaches for the personalization
of amplification in hearing aids},
author={Tasnim, Nafisa Zarrin and Ni, Aoxin and Lobarinas,
Edward and Kehtarnavaz, Nasser},
journal={Sensors},
volume={24},
number={5},
pages={1546},
year={2024},
publisher={MDPI}}
Lors de la rédaction, l’auteur pourra utiliser la fonction \cite{} pour citer dans le texte une source déjà intégrée dans sa bibliographie. Pour avoir plus d’astuces sur BiBtex et/ou Latex en général, je te recommande le très bon site de l’ENS.
V – Comment citer ses sources lors de la rédaction ?
Après avoir judicieusement sélectionné ses sources. Il faut les citer proprement. Et ben c’est ici que tout se complique. SAUF si tu utilises Zotero (par exemple) qui te le fera à ta place! Mais parfois, cela ne fonctionne pas toujours. Alors, pour t’ aider à bien citer tes références, je te conseille le site SCRIBBR qui donne une liste exhaustive des différentes sources qu’il serait trop long de détailler ici. Néanmoins, voici plusieurs exemples de sources à citer dans le texte et dans la bibliographie qui se retrouve très régulièrement dans les mémoires d’audioprothèses. Et oui, il est essentiel de faire le distinguo entre “citer dans le texte” et “citer dans la bibliographie” en fin de document.
Citer une source dans la bibliographie en fin de document se fera de manière complète avec le nom de l’auteur (ou des auteurs), le titre de l’article scientifique, la revue, l’année de publication, etc. Tandis que seul le premier auteur (avec et al., s’il y en a plusieurs) et l’année de publication apparaîtront dans le texte.
Voici un exemple:
Citer dans la bibliographie : Praveen Sundar, P. , Ranjith, D., Karthikeyan, T., Kumar, V. V., & Jeyakumar, B. (2020). Low power area efficient adaptive FIR filter for hearing aids using distributed arithmetic architecture. International Journal of Speech Technology, 1-10.
Et cette même référence dans le texte : Les auteurs (Praveen Sundar et al., 2020) propose une nouvelle architecture du filtre de décimation …
Attention toutefois s’il y a QUE 2 auteurs :
Belin, P., & Zatorre, R. J. (2000). ‘What’,‘where’and ‘how’in auditory cortex. Nature neuroscience, 3(10), 965-966.
Donnera : Le cortex auditif présente une physiologie particulière (Belin & Zatorre ; 2000) qui …
Voici quatre autres exemples :
Comment citer individuellement dans le texte un mémoire, une thèse ou un article scientifique :
Article : Sundar et al., 2020
Mémoire : Calmette A., 2017
Thèse : Vannson N., 2016.
Les trois ensemble dans un texte (Du plus récent au plus anciens). Les différentes sources citées ici (Sundar et al., 2020 ; Calmette A., 2017 ;Vannson N., 2016) sont des exemples de sources bibliographiques.
Un article de loi (Il y a beaucoup de façon de citer un article de loi. Voici la plus commune) : Dans la bibliographie : Article R.5124-59 du Code de la Santé Publique. Ou bien Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances (J.O. 29 décembre 1967). Dans le texte : La loi du 28 décembre 1967 indique que … Et voici le décret de la loi du reste à charge zéro. Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.
Un site web : Si tu fais référence à un site global : Pas de bibliographie, juste une mention dans le texte : le superbe site memau (https ://memau.eu). Si référence à un article précis du site : (Format : Titre article. Date.URL). Dans la bibliographie : Incendies en Australie : alertes « catastrophiques » en Australie-Méridionale et à Victoria.(2019, novembre 11). Le Monde. https ://www.monde.fr/news/australie-enfeu. Dans le texte, la terre australienne brûle depuis 3 mois («Incendies en Australie», 2019) et les conséquences …
Conclusion
La bibliographie est une étape clé dans la création d’un travail de fin d’études. L’important n’est pas la quantité de documents cités mais bien les plus utiles.
La démarche bibliographique commence par une thématique large puis se recentre progressivement vers la problématique (ou question) du sujet qui sera ensuite traitée. Cette démarche est simple (si elle est bien menée) mais demande un peu d’investissement de la part de chaque personne, étudiant comme encadrant. En effet, la qualité d’un mémoire se démontre par la qualité de cette recherche bibliographique qui permet de bien rédiger l’introduction et la discussion. La maîtrise d’outils de recherche bibliographique ainsi que d’agencement bibliographique font gagner, in fine, beaucoup de temps et permettent de rendre un travail de qualité.
Bon courage et bonne recherche bibliographique
Exemple de bibliographie citée dans le document
[1] HAS. Niveau de preuve et gradation des recommandations de bonne pratique – État des lieux. 2013 ;2013. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf. [Consulté le : 21/10/2024].
[2] Praveen Sundar P, Ranjith D, Karthikeyan T, Vinoth Kumar V, Jeyakumar B. Low power area efficient adaptive FIR filter for hearing aids using distributed arithmetic architecture. International Journal of Speech Technology. 2020 ;23(2) :287–296.
[3] Belin P, Zatorre R. ‘What’,‘where’and ‘how’in auditory cortex. Nature neuroscience. 2000 ;3(10) :965–966.